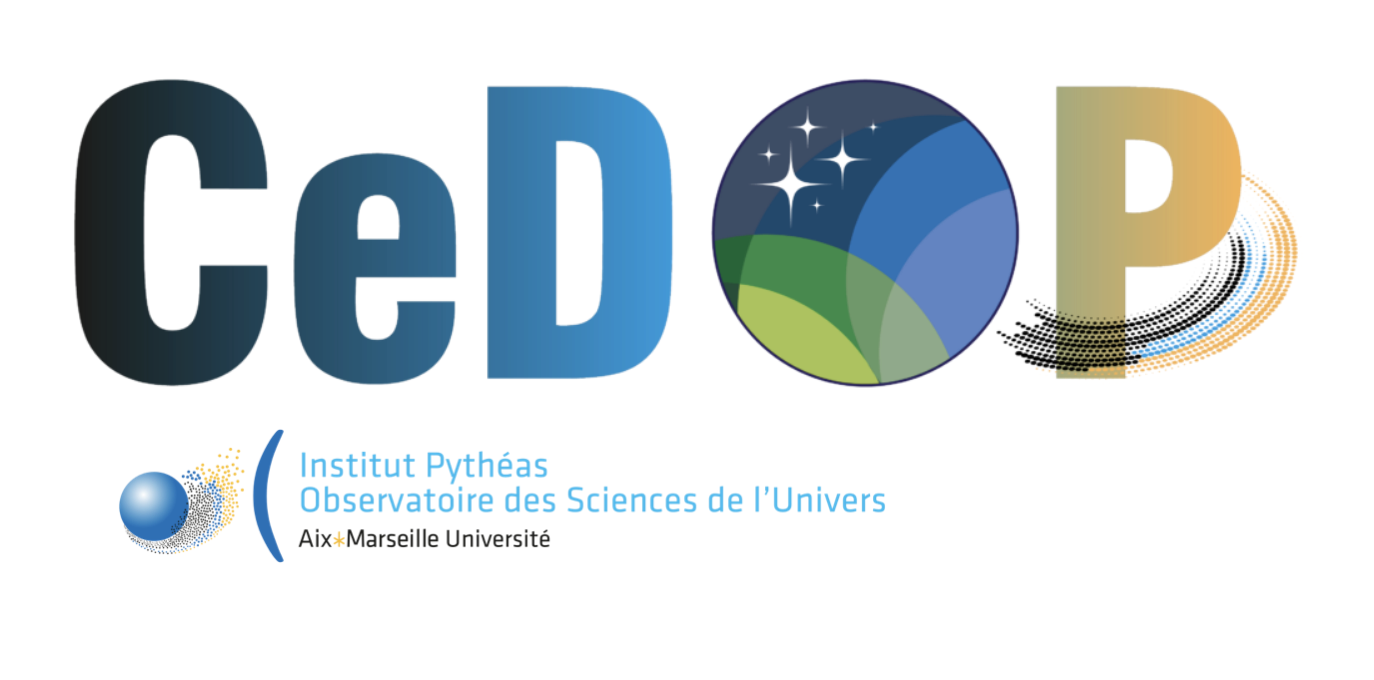Actions Nationales d’Observation INSU
Astronomie-Astrophysique
L’astronomie est structurée autour de moyens nationaux ou internationaux qui soutiennent la recherche scientifique dans les différents domaines de la discipline et sont accessibles à la communauté scientifique française. Les activités labélisées dans le cadre des missions de service en Astronomie couvre la construction et l’opération d’instruments et des grands moyens d’observation et de surveillance astronomiques ; la production, la distribution et la maintenance de logiciels ; la production de grands relevés, de données d’observation ou de simulation ; le développement d’outils d’archivage et de distribution des données et d’outils d’interrogation et de manipulation des grandes bases de données hétérogènes.
Les Actions Nationales d’Observation
OSU Pythéas responsable ou partenaire
ANO AA-ANO2 : Instrumentation des grands observatoires au sol et spatiaux 2 (OSU Pythéas Responsable) / 4 (OSU Pythéas Partenaire)

Description projet
La mission PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) a été sélectionnée par l’ESA le 19 février 2014 comme troisième mission de classe intermédiaire (M3). Le lancement aura lieu en 2026. L’objectif principal est la détection de planètes telluriques analogues à la Terre, l’exploration de leurs propriétés physiques grâce à la mesure très précise de leurs paramètres, masse et rayon, en particulier avec des mesures d’astérosismologie et l’étude de l’évolution combinée des étoiles et de leur cortège planétaire. Le LAM assure la responsabilité de plusieurs modules du segment sol sur les aspects exoplanètes, au niveau du centre de mission, le PLATO Data Center (PDC) et de la préparation scientifique (PSM).
Les tâches de service proposées
– Définition des algorithmes d’évaluation et de classements des candidats transits et – la participation à l’élaboration du catalogue d’entrée qui va être construit en préparation aux observations (PSM) ;
– Développement et la fourniture de logiciels de détection des transits, d’estimation des paramètres des systèmes planétaires et la gestion des performances de l’ensemble du pipeline exoplanètes en charge de produire les candidats planètes, les planètes confirmées et leurs caractéristiques ;
– Développement d’outils de contrôle des sorties du pipeline exoplanètes (visualisation, et outils de ré-analyse si nécessaire), en support aux analyses de données ;
– Participation à la spécification puis au développement de la base de données ancillaire qui va rassembler toutes les données auxiliaires, c’est-à-dire autres que le catalogue d’entrée plus les données d’observations complémentaires et les produits associés.
Contact local : Magali Deleuil (LAM)
Responsable national : Magali Deleuil (LAM)
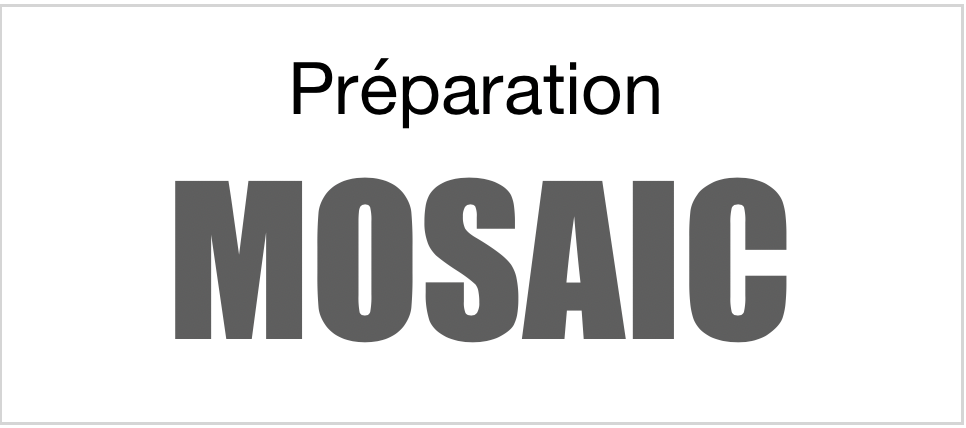
Description projet
MOSAIC est le spectrographe multi-objets (MOS) de l’ELT (ELT-MOS). Il exploitera la pleine résolution d’un télescope de 39 m, combinée à une correction par optique adaptative de (GLAO), sur un très grand champ de vision, pour atteindre une sensibilité jamais égalée auparavant. De très nombreux projets scientifiques seront développés sur MOSAIC/ELT, depuis l’étude des premières galaxies formées dans l’univers jusqu’aux étoiles les plus faibles dans l’univers local, touchant une large communauté. MOSAIC possède une ample couverture en longueur d’onde, du visible (0.39 microns) au proche IR (1.8 microns), et deux modes d’observation : le mode à multiplex élevé (~200 objets), et le mode à résolution spatiale modérée (IFUs dans IR) avec un multiplex de 8 objets. Grace à ce dernier mode, MOSAIC sera le seul instrument capable de faire un inventaire complet de la matière sous sa forme baryonique (phases du gaz dans le halo testées via les raies UV décalées dans le visible à z~ 3.5) et sombre (courbes de rotation étendues des galaxies à z=2-4 en IR assisté par la GLAO). En spectroscopie à résolution modérée (R= 5000) MOSAIC pourrait être plus sensible que JWST en detection des sources ultra-faibles en NIR, offrant potentiellement jusqu’à deux magnitudes supplémentaires en profondeur à cette résolution, cela dépendant de la qualité de la soustraction du ciel. Des observations simultanées seront possibles, combinant différents modes et domaines de longueur d’onde. MOSAIC a été optimisé pour réaliser efficacement des relevés d’objets faibles.
MOSAIC a commencé sa phase B2 en septembre 2025. Le consortium MOSAIC est composé de 25 partenaires distribués dans 13 pays (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Finlande, Italie, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Brésil, et États-Unis), travaillant en collaboration avec l’ESO. Sous la direction du CNRS-INSU, les laboratoires français sont fortement impliqués, avec notamment le leadership du projet et autres responsabilités systèmes/sous-systèmes :
- PI et chef de projet français (LAM)
- Project Manager (UNIDIA)
- AITV Instrument (LAM)
- Spectro-NIR (LAM)
- SSO (LAM & UNIDIA/LUX)
- Instrument System Engineering & Project Scientist (UNIDIA/LUX)
- Fiber Link (UNIDIA/LUX)
- Electronic and Instrument Control System: + EFOSOFT (IRAP)
- Optical Relays (OCA/Lagrange)
- Coordinateurs des Science Working Groups 1, 2 et 6 (LAM)
- NIR Channel Scientist (LAM)
Les tâches de service proposées
Les tâches de service proposées dans cet SNO, mises à jour en janvier 2025, sont les suivantes :
- Tâche 1 (jusqu’à livraison de l’instrument) : “Software Scientist”. Le besoin de cette tâche spécifique est apparu avec la fin de la phase B1. Cette tâche comprend plusieurs volets :
- Coordonner les travaux effectués dans les WP “DRS”, “ObsPrep” et “Survey Scheduling” (WP17) en ce qui concerne le développement de software, sachant que la responsabilité de l’ensemble du software d’observation est française.
- Assurer la connexion entre les développeurs dans ces WP cités ci-dessus et ceux travaillant dans le WP “CALEMOS” (Calibration unit, WP12), et plus particulièrement le “Calibration Scientist”, qui se trouve à l’UCM (Espagne).
- Assurer la connexion entre les développements de software d’observation ci-dessus et le Control Commande (EICS), WP16 dont la responsabilité se situe à l’IRAP (Toulouse).
- Participer activement aux réunions du groupe PICCS (MOSAIC Project/Instrument/Calibration/Channel Scientists), composé du Project Scientist, le Instrument Scientist, les VIS & NIR Channel Scientists, le Calibration Scientist et le PI. Etre force de proposition dans ce groupe (en ligne avec les activités ci-dessus).
- Proposer des tests de validation orientés science pour le software d’observation, calibration, et plus tard d’analyse des données scientifiques.
- Participer activement aux réunions du WP SSO (Science SOftware, WP17), dont le volume et fréquence devront augmenter au fur et à mesure que le projet avance. Servir de lien et assurer la cohérence entre ce qui est fait dans ce WP (contractuel avec l’ESO), les besoins de SWGsScience Working Groups, et les priorités des Channel Scientists.
- Pendant et après le commissioning, proposer et vérifier l’exécution des changements dans le software d’observation qui s’avéreront nécessaires, faisant le lien entre les scientifiques et les développeurs.
- Tâche 2 (court terme) : Mise en place et exploitation d’un simulateur de plan focal intégrant les réponses optiques de l’ensemble de la chaine instrumentale et atmosphère, afin de valider la faisabilité et les temps d’exécution d’observations clé d’objets-type définissant les priorités de l’architecture (Phase B2).
- Tâche 3 (court terme) : Finalisation de l’ensemble des spécifications techniques de l’instrument (Phase B2). Tests observationnels des spécifications clés et de l’opérabilité de l’instrument en utilisant des données disponibles sur des instruments actuels et à venir (KMOS, MUSE, MOONS,…), ainsi que des simulations spécifiques.
- Tâche 4 (court à moyen terme) : Optimisation de la soustraction du ciel pour instruments fibrés et à IFU multiples. Caractérisation de la stratégie observationnelle optimale pour observations des objets extrêmement faibles. Analyse et caractérisation (distribution de la lumière) des sources les plus faibles de grand intérêt scientifique (des premières sources de l’Univers lointain aux étoiles ou amas d’étoiles dans l’Univers local).
- Tâche 5 (court à moyen terme) : Optimisation des modes simultanés de l’instrument (VIS et NIR, moyenne et haute résolution), qui seront clés pour la communauté lors de la préparation des grands relevés avec MOSAIC et qui sont d’une grande complexité.
- Tâche 6 (jusqu’à livraison de l’instrument) : Mise en place et test d’algorithmes et d’outils de préparation, réduction, analyse des observations, et simulation de données de test pour le DRS. Ces outils seront mis à la disposition de la communauté, élargissant le périmètre des outils exigés par l’ESO et livrés avec l’instrument.
Ces tâches sont souvent transverses entre différents WP, et devront évoluer au cours du cycle de développement de l’instrument vers des tâches de spécifications et d’étude de performance des sous-systèmes, puis de modélisation fine de ceux-ci, et enfin de caractérisation et de validation au cours des phases d’intégration et de tests puis de commissioning sur le ciel.
Contact local : Roser Pello (LAM)
Responsable national : Roser Pello (LAM)

Description projet
Lancée avec succès en juin 2024 pour une durée de vie nominale de trois ans, extensible d’au moins deux années supplémentaires, la mission sino-française Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor (SVOM) apporte d’ores et déjà une contribution majeure à deux axes de recherche centraux issus des avancées récentes dans l’étude des sursauts gamma : d’une part, leur utilisation comme outils de cosmologie, et d’autre part, la compréhension fine des mécanismes physiques à l’origine de ces phénomènes.
La mission repose sur une approche multi-longueurs d’onde des sursauts gamma. Le satellite embarque quatre instruments complémentaires : ECLAIRs, un télescope X dur–gamma assurant le déclenchement des alertes ; GRM, un ensemble de détecteurs gamma opérant à plus haute énergie ; MXT, un télescope X ; et VT, un télescope opérant dans le domaine visible. Grâce à ce dispositif, SVOM est capable de fournir en temps quasi réel la position des sursauts via un réseau d’antennes VHF judicieusement réparties à la surface du globe.
Ces informations sont ensuite transmises aux télescopes robotiques au sol, en particulier COLIBRI, qui prend immédiatement le relais afin d’affiner la localisation et d’estimer la distance du sursaut. COLIBRI déclenche également des observations complémentaires sur les plus grands instruments d’observation disponibles (VLT, ELT, JWST, ALMA, etc.).
Le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) occupe une position centrale au sein de la mission en tant que co-PI. À ce titre, il joue un rôle clé dans le développement du segment sol, notamment à travers la conception de la Mission Database et des outils d’aide aux Burst Advocates. Le LAM est également responsable de la coordination du suivi multi-longueurs d’onde, en tant que PI du télescope robotique franco-mexicain COLIBRI, et de l’organisation des observations sur les grands moyens internationaux.
Les tâches de service proposées
– Maintenance et exploitation du télescope robotique franco-mexicain, COLIBRI.
– Maintenance de la Mission Database (SDB) et des outils d’aide aux Burst Advocates (iFSC-Tools).
Contact local : Stéphane Basa (LAM)
Responsable national : Bertrand Cordier (CEA)

Description projet
MIRS (MMX InfraRed Spectrometer) est un spectromètre imageur dans le proche infra-rouge (0.9-3.6 microns) à bord de la mission MMX. La mission MMX (Martian Moon eXploration) de la JAXA est la première mission de retour d’échantillons du satellite Phobos. Elle prévoit également une exploration du système de la planète Mars. L’objectif principal de la mission est de déchiffrer l’origine des lunes martiennes, ce qui fournira des informations importantes sur la formation des planètes et sur les conditions d’apparition de l’eau sur les planètes de type terrestre.
MMX sera lancée en 2026 vers le système martien pour ramener des échantillons de la surface de Phobos, effectuer des observations détaillées de Phobos et de Deimos et surveiller le climat de Mars. La mission effectuera un voyage aller-retour en cinq ans, avec retour sur Terre des échantillons de Phobos en 2031. La sonde arrivera dans le système de Mars en 2027. Elle restera trois ans sur des orbites quasi-satellitaires (QSO) autour de Phobos à différentes altitudes pour sélectionner les sites d’échantillonnage et d’atterrissage.
MIRS permettra d’étudier la composition de Phobos, Deimos et de caractériser les variations temporelles dans l’atmosphère de Mars. Il sera également un instrument fondamental pour contribuer à la sélection des deux sites de collecte d’échantillons à la surface de Phobos.
Les tâches de service proposées
– Participation aux simulations des scènes observées à partir des données orbitales et les modèles topographiques des objets.
– Participation à la définition et à l’implémentation des traitements sols : géo-référencement des données et reconstruction des images.
Contact local : Laurent Jorda (LAM)
Responsable national : Antonella Barucci (LESIA/Observatoire de Paris)

Description projet
La mission Comet Interceptor est une mission de la classe F (« Fast ») du programme Cosmic Vision de l’ESA. Actuellement en phase B, elle sera lancée en 2029. La mission Comet Interceptor placera trois sondes spatiales (une principale et deux secondaires plus petites) au point de Lagrange L2 Terre-Soleil, en attente du passage dans le voisinage d’une comète provenant du nuage d’Oort ou d’un objet interstellaire, pour aller l’intercepter, l’observer, et le caractériser.
La France est impliquée dans la fourniture de matériel pour 3 instruments de la sonde Comet Interceptor:
• La sonde à impédance mutuelle pour l’instrument COMPLIMENT du package DFP (Dust, Field, Plasma), qui étudiera la poussière, le champ électrique et le plasma dans la coma (fourniture du LPC2E à Orléans)
• L’analyseur d’électron pour l’instrument LEES du même package DFP (fourniture de l’IRAP à Toulouse)
• Le miroir primaire de la caméra CoCa, qui étudiera le noyau et sa coma (fourniture du LAM à Marseille)
L’objectif de cet ANO2 est le développement de ces 3 instruments spatiaux (COMPLIMENT, LEES et CoCa), puis leur exploitation scientifique.
Les tâches de service proposées
– Tâche 1 : Assurer le suivi du développement instrumental pendant ses phase de conception et de réalisation, ainsi que les interactions avec les partenaires industriels, les collaborateurs étrangers, les agences, et les tutelles
– Tâche 2 : Participer aux phases d’intégration, de tests, et d’étalonnages au sol des instruments
– Tâche 3 : Définir les modes opératoires et les séquences de calibration et d’observation en vol, pour les différentes phases de la mission (post-lancement, croisière, parking en L2 Terre-Soleil, approche, et survol)
– Tâche 4 : Produire des données spatiales de niveau élevé
Contact local : Olivier Groussin (LAM)
Responsable national : Pierre Henri (OSU Centre)
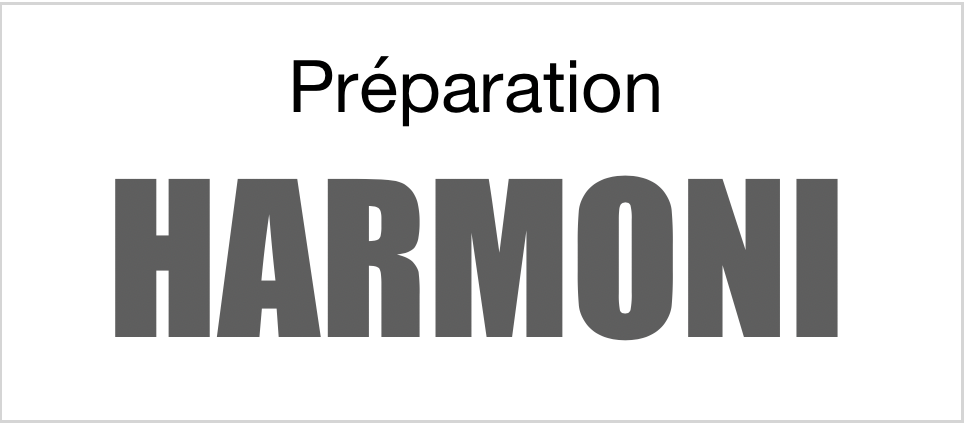
Description projet
HARMONI est l’un des instruments de première lumière de l’ELT. HARMONI est un spectrographe intégral de champ (IFU) opérant dans le proche infrarouge (0.8-2.45 µm) à moyenne (R=3000) résolution spectrale. Il couvre un champ de vue entre 1 et 4 arcsec2 avec un échantillonnage spatial variant entre 6 et 25 milliarcsec. HARMONI est dédié à l’observation détaillée d’objets astrophysiques pour lesquels le pouvoir collecteur d’un télescope de 39 m d’ouverture et d’une très haute résolution spatiale offre un gain spectaculaire. Pour exploiter pleinement la limite de diffraction de l’E-ELT, HARMONI sera équipé de deux systèmes d’Optique Adaptative (OA). Le premier est un système d’OA classique (SCAO) et le deuxième sera un système d’OA grand champ, assisté par étoiles lasers (MCAO). Les cas scientifiques principaux d’HARMONI couvrent un large spectre, depuis l’étude et la caractérisation des exo-planètes, l’étude des populations stellaire dans les galaxies proches, et jusqu’aux galaxies à grand décalage vers le rouge. La première lumière est prévue pour fin 2034 et le projet se prépare pour la FDRs en 2028.
Le consortium HARMONI est constitué de 9 laboratoires partenaires avec: l’Université d’Édimbourg (PI : James Dunlop), le Laboratoire d’Astrophysique de l’Université d’Oxford (CoI : M. Tecza), le UK Advanced Technology Centre d’Edinburgh (CoI : O. Gonzalez,), le CRAL (CoI : N. Bouché), le département Astrophysique de l’Université de Madrid (CoI : J. Piqueras López), l’Institut d’Astrophysique des Canaries (CoI : B. García-Lorenzo) , le LAM (Deputy PI : B. Neichel, CoI A. Delsanti), l’Université de Durham (CoI : K. O’Brien) et l’Université de Michigan (coI : M. Mateo). En France, on dénombre également trois instituts associés : l’IPAG, l’IRAP et l’ONERA.
Les tâches de service proposées
Les tâches de services proposées au CRAL sont les suivantes :
T1- Proposition et validation d’algorithmes avancés pour les particularités d’HARMONI : il s’agit de contribuer à la réflexion sur les choix d’algorithmes, puis à leur validation, concernant les calibrations basées sur des observations du ciel: l’astrométrie, la correction des telluriques, et la soustraction optimale du ciel. En particulier, nous projetons d’utiliser le mode multi-lectures pour les détecteurs: il faudra exploiter cette possibilité de manière optimale pour les algorithmes ci-dessus. Des prototypes pour les algorithmes critiques doivent être livré à la revue FDR, prévue en 2024-2025.
T2- Préparation de données brutes fictives : Celles-ci sont essentielles pour pouvoir tester et valider la chaîne d’algorithmes de réduction des données. Pour ce faire, il s’agit générer avec l’INM des données ‘raw’ fictives d’observation typique (à partir de simulations astrophysiques ou d’observations existantes ou autre), dans les principaux modes d’HARMONI (champs stellaires, galaxies, champs profonds), ainsi que des cibles spécifiques (cibles mouvantes, champs astrométriques). Ces données brutes/raw simulées serviront de test pour la réduction des données avec le pipeline. Ces résultats de réduction seront par ailleurs contrôlés dans une étape de validation par rapport aux données en entrée de l’INM, avec une quantification des erreurs et une étude de l’impact sur la science.
T3- Participation au choix des tests de validation du pipeline qui seront à effectuer en laboratoire et/ou sur le ciel au cours des phases de tests globaux puis de commissioning de l’instrument.
Le LAM est en charge du développement des Optiques Adaptatives. Les tâches de services pour le LAM concernent les systèmes d’Optique Adaptative, la SCAO et la MCAO. Deux tâches sont identifiées :
1/ Développement système AO: simulation des performances, analyses système, méthodes de reconstruction tomographique, lois de commande. Ces tâches sont primordiales pour la phase de FDR, puis devront évoluer au cours du cycle de développement de l’instrument vers des tâches de spécifications et d’étude de performance des sous-systèmes, puis de modélisation fine de ceux-ci, et enfin de caractérisation et de validation au cours des phases d’intégration et de tests puis de commissioning sur le ciel.
2/ Reconstruction de la fonction d’étalement de point (PSF). Le LAM est responsable du WP « PSF » qui devra fournir des algorithmes de prédictions de PSF pour les deux modes d’OA. Cela concerne une estimation rapide de la performance via la télémétrie de l’OA, et une reconstruction fine de la PSF pour assister les analyses scientifiques. Ce travail peut inclure des activités de démonstration et/ou de prototypage en laboratoire ou avec des démonstrateurs.
Avec le LAM, l’IPAG est en charge du développement d’un bras d’imagerie à haut-contraste permettant la caractérisation d’exoplanètes. Les tâches de service à l’IPAG portent sur le sous-système d’imagerie à haut-contraste, en particulier vis-à-vis de son développement, et de la préparation des outils de traitement du signal destinés à traiter les données. Le développement inclut la mise en œuvre d’une analyse système, l’estimation des performances – qui repose en partie sur les algorithmes de de post-traitement – et l’élaboration des processus de contrôle des aberrations non-communes, en lien étroit avec le mode SCAO de l’instrument. Ces tâches sont primordiales pour la phase de FDR, puis devront évoluer au cours du cycle de développement de l’instrument vers des tâches de spécifications et d’étude de performance du sous-systèmes, puis de modélisation fine de celui-ci, et enfin de caractérisation et de validation au cours des phases d’intégration et de tests puis de commissioning sur le ciel. Le traitement des données s’appuie sur leur diversité temporelle et spectrale afin de séparer le signal stellaire de celui des compagnons et structures situées dans l’environnement proche de l’étoile. La résolution spectrale fournie par HARMONI motive en particulier la mise au point d’algorithmes utilisant la résolution spectrale de l’instrument, en complément des algorithmes d’imagerie différentielle angulaire.
Contact local : Benoit Neichel (LAM)
Responsable national : Nicolas Bouché (CRAL)
ANO AA-ANO3 : Stations d’observation 1 (OSU Pythéas Responsable)
Les astronomes ont à leur disposition des moyens lourds nationaux ou internationaux dont la gestion est une tâche souvent exigeante, et qui n’a pas de retour direct en termes de publications. Pour reconnaître ce service à la communauté cette action comprend : la gestion des stations d’observation; les activités instrumentales qui leur sont propres; l’opération des instruments après leur mise en service; les actions amont qui visent la qualification et la protection des sites d’observation existants et futurs, dans toutes les fenêtres spectrales (optique, radio).
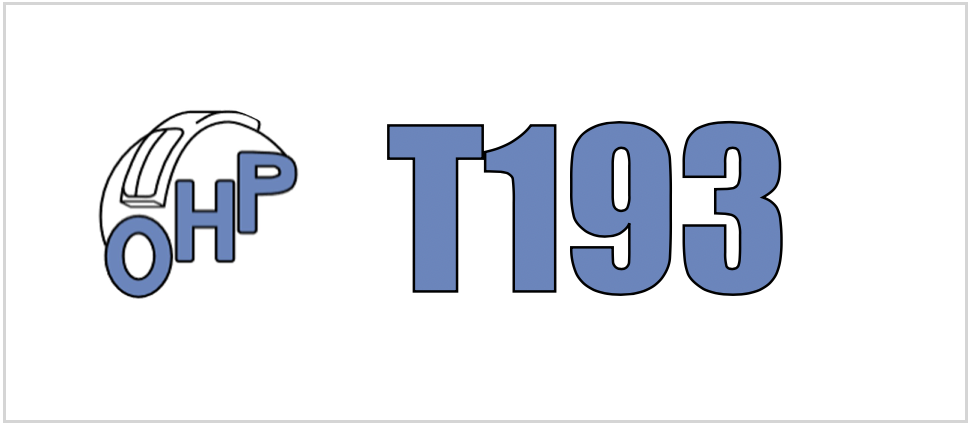
Description projet
Ce service concerne le suivi de la station d’observation de l’OHP avec le télescope de 193 cm. Les deux instruments installés au télescope sont SOPHIE et MISTRAL.
SOPHIE est un spectrographe à haute-résolution et à haute-précision reconnu internationalement pour ses caractérisations d’exoplanètes. Environ 75 % des nuits du 193 sont consacré a des programmes d’observation d’exoplanètes.
MISTRAL est lui un spectro-imageur basse resolution multi-usage. Son temps de réaction rapide (< 30 min) lui permet de pouvoir suivre le ciel transient jusqu’à des magnitudes de l’ordre de 20 et sera crucial dans le cadre par exemple du suivi sol de SVOM. Il est également adapté à des observations visiteur classiques sur des sujets allant du stellaire à l’extragalactique. Jusqu’à 15 % des nuits du T193 seront consacrées à ces thématiques avec cet instrument. Il est aussi possible d’y opérer des instruments visiteurs comme GHASP, CIGALE, MYOSOTIS ou tout autre instrument au foyer Cassegrain du T193. Ce service d’observation sert la communauté astronomique française des programmes nationaux et des programmes européens Opticon (15 nuits/semestre).
Les tâches de service proposées
Instrument SOPHIE
– Participation à l’amélioration du logiciel de réduction des données afin d’améliorer les performances de l’instrument.
– Adaptation du logiciel de réduction des données à la nouvelle camera SOPHIE-red.
Instrument MISTRAL
– Support aux observations en mode “alerte”.
Contact local : Isabelle Boisse / Hervé Le Coroller (SOPHIE) et C. Adami (MISTRAL)
Responsable national : Marc Ferrari (OHP)
ANO AA-ANO4 : Grands relevés, sondages profonds et suivi à long terme 2 (OSU Pythéas Partenaire)
Les grands relevés sont donc une des principales sources des bases de données en astronomie. Cette Action nationale d’observation couvre la définition et la conduite de grands programmes d’observations d’ampleur internationale ayant pour but la cartographie du ciel dans différents domaines spectraux, le suivi temporel d’objets sur de longues échelles de temps, et l’observation systématique de populations d’objets. Les activités concernées couvrent la préparation initiale, la définition, la réalisation du relevé proprement dit, la réduction des données, leur archivage et leur diffusion finale. La mise à disposition de la communauté des données, de manière systématique et dans les délais les plus courts possibles, constitue la mission de cette Action nationale d’observation.

Description projet
Euclid est une mission spatiale de l’ESA, co-financée par les agences nationales (CNES, CNRS, CEA en France) avec le soutien de nombreuses universités. Dédiée à l’étude de l’accélération de l’expansion de l’Univers, Euclid conduira un sondage systématique de 15000 degrés carré en imagerie (visible, NIR) et en spectroscopie sans fente NIR (grism). Euclid a été sélectionnée par l’ESA en Octobre 2011 et le lancement a eu lieu le 1er juillet 2023. Les phases de tests et de vérification des performances touchent à leur fin et le relevé doit commencer début 2024. La France est particulièrement impliquée dans Euclid, avec la responsabilité de l’ensemble du projet, la coordination de plusieurs groupes scientifiques, la responsabilité du spectrographe infrarouge NISP, la responsabilité de plusieurs modules du segment sol. Le LAM est très fortement mobilisé sur Euclid, avec un haut niveau de responsabilité au sein des groupes scientifiques, sur le développement du segment sol et avec la maîtrise d’œuvre de l’instrument NISP.
Les activités segment sol comprennent : conception, développement, tests, validation et livraison des algorithmes, des logiciels et des pipelines de traitement et contrôle qualité des données associées à la modélisation, à la production et à l’exploitation des données d’Euclid et des relevés complémentaires. Ces développements doivent se faire au sein des ’Organisation Units’ (OUs) auxquels le LAM contribue pleinement : OU-SPE (LAM responsable), mais aussi OU-SHE, OU-SIM, OU-PHZ, OU-LE3 et OU-MER.
Le prolongement des activités qui relevaient de l’ANO2 (Euclid) se fait maintenant au sein d’un SNO Euclid Survey unique relevant de l’ANO4.
Les tâches de service proposées
Les tâches proposées au LAM peuvent couvrir tous les aspects de la mission depuis les deux principales sondes de la science coeur (Weak lensing et Galaxy Clustering) jusqu’à la science “legacy” extragalactique (galaxies et amas de galaxies). Toutes les activités de validation, de simulations et de developpement d’outils logiciels de haut niveau en vue de l’exploitation scientifique de la mission sont recevables. Des besoins plus pressants sur la simulation d’images et de spectres (dans le cadre d’OU-SIM) ainsi que sur la verification des performances scientifiques (SPV) sont à combler.
Contact local : Raphaël Gavazzi (LAM)
Responsable national : Karim Benabed (IAP)

Description projet
WEAVE est un spectrographe multi-objet à très grand champ pour le William Herschel Telescope (WHT). WEAVE est la pierre angulaire de l’accompagnement spectroscopique au sol de la mission Gaia dans l’hémisphère Nord ainsi qu’un projet énergie sombre de prochaine génération mesurant les oscillations baryoniques acoustiques (BAOs) via le milieu intergalactique sur la ligne de visée des quasars. La France (CNRS/INSU) a rejoint officiellement le projet en 2015, ouvrant ainsi la collaboration à toute la communauté française. Au moins 70% du temps d’observation sur le WHT sera réservé pour ce projet pendant 5 ans, c’est-à-dire au moins 8.5 millions d’heures-fibres. Le projet offre les deux modes d’observation : un mode à basse résolution spectrale (R=5 000) et une couverture spectrale de 370-1000 nm et un mode à haute résolution spectrale (R=20 000) dans deux domaines spectraux plus limités. Les relevés prévus pour WEAVE incluent d’autres composantes importantes comme le suivi optique des relevés LOFAR, une composante amas de galaxies, et une composante stellaire. Le relevé des quasars (WEAVE-QSO) permettra de caractériser la toile cosmique, le milieu circumgalactique et de mesurer les paramètres cosmologiques.
La tâche de service WEAVE au LAM concerne l’optimisation globale des différents relevés et plus spécifiquement le soutien du relevé WEAVE-QSO. Le relevé WEAVE-QSO fait suite au relevé BOSS/eBOSS et coïncidera avec le relevé DESI dont il sera très complémentaire. Ce relevé WEAVE produira 400,000 spectres de QSOs à grand redshift.
Les tâches de service proposées
– Gestion du relevé. Liaisons dans WEAVE (entre WEAVE-QSO, le relevé d’Archéologie Galactique et le relevé de galaxies LOFAR) et à l’extérieur de WEAVE (avec J-PAS et Gaia pour les cibles).
Sélection des cibles (basées sur J-PAS et Gaia).
– Préparation des catalogues : identification et redshifts de quasars, identification des BALs et identification des DLAs.
– Configuration des fibres et stratégie d’exécution (tiling). Mise en priorité et partage des fibres dans les champs en commun avec le relevé d’Archéologie Galactique et le relevé de galaxies LOFAR.
– Contrôle de qualité des spectres. Initialement préparation et analyse des mocks puis analyse des données une fois le relevé en cours.
Contact local : Matthew Pieri (LAM)
Responsable national : Vanessa Hill (OCA)
ANO AA-ANO5 : Centres de traitement, d’archivage et de diffusion de données 2 (OSU Pythéas Responsable) / 3 (OSU Pythéas Partenaire)
Les grands observatoires astronomiques au sol et spatiaux fournissent des volumes importants de données rendues publiques après une courte période d’exclusivité. Cette diffusion rapide à l’ensemble de la communauté vise à maximiser le retour scientifique d’investissements lourds. Cette ANO recouvre trois types d’activités : le traitement de données, leur archivage et la diffusion au sein de structures dédiées qui possèdent les expertises et ressources nécessaires. Pour valoriser les observations, la communauté peut avoir besoin de données de références issues de calculs théoriques, d’expériences ou de simulations accompagnés des outils nécessaires à leur exploitation. Les besoins peuvent également concerner l’accès à des codes numériques de référence.
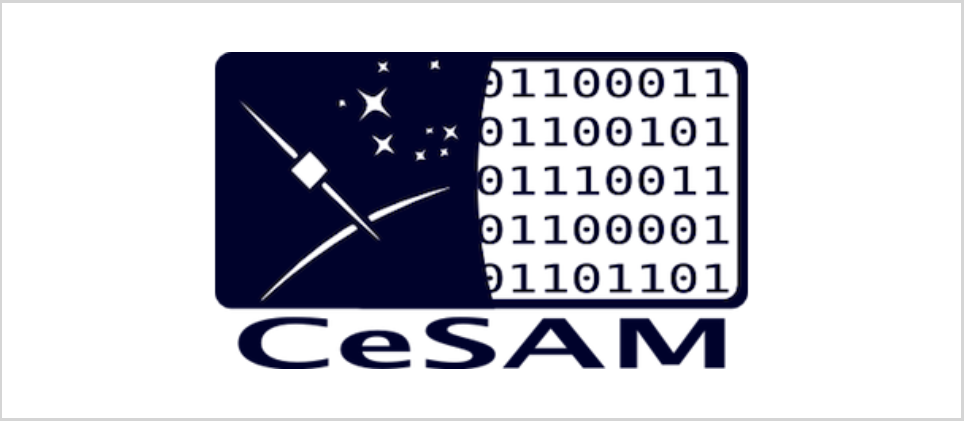
Description du CeSAM Data Centre
L’ANO5 CeSAM Data Center regroupe toutes les activités menées au LAM/CeSAM de traitement, analyse, archivage et mise à disposition des données de programmes d’observations de grande ampleur, notamment via les ANO5 GASPIC et HCDC et les ANO4 liés aux projets sols et spatiaux du LAM/OSU Pythéas. Le centre de données permet de produire des données à forte valeur ajoutée, via le développement et/ou l’intégration de logiciels spécifiques, principalement dans le domaine de la spectroscopie extragalactique, mais aussi dans le domaine de l’analyse temporelle de courbes de lumière d’exoplanètes et de l’imagerie planétaire. Il en assure aussi la pérennité et l’accessibilité à toute la communauté internationale. Le Centre met également à disposition de la communauté scientifique des outils génériques et/ou spécifiques développés dans le cadre de projets scientifiques et compatibles avec les standards de l’Observatoire virtuel (OV).
Les tâches de service proposées
– Interface avec les scientifiques utilisateurs du centre de données: instruction des demandes et rapport éventuel au conseil scientifique du LAM.
– Pilotage scientifique/prospective: suivi bi-mensuel des activités du centre de données et participation à la journée du CeSAM. Participation aux réunions organisées par les tutelles (CNRS, AMU, CNES) sur des thèmes concernant le centre de données (archivage, certification, accès aux données, etc.).
– Suivi régulier des ANO4-AA et ANO5-AA de l’OSU Pythéas, en particulier de l’ANO5 GASPIC. Participation au comité observation de l’OSU.
– Rédaction de demandes de moyens annuelles à l’OSU Pythéas et aux tutelles, en particulier pour la jouvence informatique et pour les missions.
Contact local : Laurent Jorda (LAM)
Responsable national : Laurent Jorda (LAM)

Description projet
Le SNO GASPIC (GAlaxy Spectrophotometry, redshifts and physical parameters Publicly available In Cesam) résulte de la fusion des deux SNOs GAZPAR et ASPIC.
GAZPAR propose des outils pour la mesure des redshifts photométriques et spectroscopiques ainsi que des paramètres physiques à partir de méthodes d’ajustement de distributions spectrales d’énergie (SED) de référence sur des données multi-couleur et des spectres. Ce service repose pour le moment sur quatre logiciels développés au LAM et à l’IAP: CIGALE, Hyperz, Le Phare et Beagle. Nous utilisons des techniques d’ajustement de SED (Spectral Energy Distribution) exploitant les données disponibles de l’ultraviolet à l’infrarouge lointain (FUV -FIR) et en modélisant la SED des différents composants d’une galaxie (étoiles, gaz, AGN, poussières). Chacun de ces codes possède ses spécificités et l’utilisation de ces codes est complexe. Une mission de notre SNO est d’abord d’offrir un soutien aux utilisateurs de ces codes. De plus, nous proposons une interface web qui permet aux utilisateurs de déposer des catalogues photométriques, analysés ensuite par les experts du SNO. Pour chaque objet d’un catalogue, nous déterminons le redshift photométrique, une classification par type étoile/galaxie/QSO ainsi que les principales caractéristiques physiques des galaxies (masse stellaire, taux de formation d’étoiles, atténuation, luminosité infrarouge, …). Les experts scientifiques du SNO fournissent à l’utilisateur les fichiers de configuration utilisés et de nombreux tests de qualité. Nous développons actuellement des outils permettant la mesure des redshifts spectroscopiques (AMAZED) que nous prévoyons d’intégrer.
La partie ASPIC (Archive of Spectrophotometry Publicly available In Cesam) repose sur l’application ANIS pour la mise à disposition des données et utilise l’expertise technique reconnue du LAM et du CeSAM de mise à disposition d’outils et de valeur ajoutée sur données à la communauté scientifique pour les programmes massifs de spectroscopie/photométrie sur des zones du ciel stratégiques. Cette approche « Sky Sweet Spots» devient en effet courante pour les grands sondages actuels et futurs qui se concentrent sur de telles zones stratégiques de façon à optimiser le retour scientifique. Dans ce cadre, le LAM est leader ou participe à de nombreux sondages profonds majeurs comme le VVDS, zCOSMOS, VIPERS, VUDS, EUCLID, ou encore PFS. Cela démontre le niveau d’expertise et de reconnaissance internationale du LAM dans ces domaines. Dans chacun de ces sondages, le CeSAM a un rôle majeur : en charge de la mesure des redshifts, du pipeline de validation, et de la production des spectres 1D.
GAZPAR et ASPIC fonctionnent conjointement : les paramètres physiques (e.g. redshifts, masses stellaire, taux de formation d’étoiles) sont mesurés sur les catalogues disponibles dans les bases de données ASPIC avec des outils GAZPAR. Elles sont déduites de l’analyse des distributions d’énergie spectrale sur la base de la photométrie multi-bande ou de la spectroscopie. Toutefois, l’ordre zéro avant d’atteindre ces paramètres avancés est:
– L’association des catalogues de spectres sur les images disponibles;
– l’association de ces images à diverses longueurs d’onde entre elles (relativement aisée si la résolution spatiale est homogène, beaucoup plus ardue pour l’association de données optiques avec des données UV ou IR où la résolution spatiale relative peut atteindre un facteur 10).
GASPIC s’appuie sur l’avis d’un comité de pilotage pour décider quel programme spectro-photométrique doit être distribué et l’évolution des outils disponible. La mise à disposition finale des données se fait à travers un environnement dédié (ANIS) avec de hauts niveaux de services. Ce service s’adresse en premier lieu à tout sondage extragalactique (français via le PNCG, mais également international), mais peut sans peine trouver une application directe dans les sondages stellaires (PNPS ou international). Le site d’accueil est en anglais de façon à ouvrir le service à l’international.
Les tâches de service proposées
– Maintenance et évolution de l’interface GAZPAR ; analyse des catalogues d’entrée et processing ; établir et fournir les catalogues de sortie ainsi que les divers diagnostiques de qualité. Une évolution des outils du service vers l’exploitation de spectres est une priorité.
– Ingestion de nouvelles données extra-galactiques dans la base ASPIC, avec une orientation vers les données JWST. L’apport de valeur ajoutée pendant et/ou après la période d’exploitation de la mission ou du programme d’observation, à travers les outils GAZPAR. Utilisation des infrastructures et environnements de mise à disposition de données du CeSAM, développées dans le cadre de projets scientifiques ou dans le cadre de l’Observatoire Virtuel (OV),
Contact local : Olivier Ilbert (LAM)
Responsable national : Olivier Ilbert (LAM)
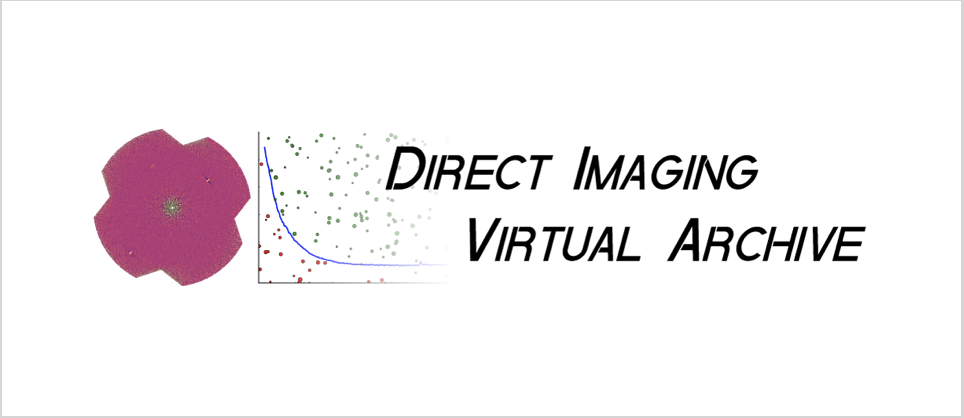
Description projet
Le service HCDC (High Contrast Data Center, anciennement centre de données SPHERE) comprend deux composantes formant un centre de référence sur l’imagerie haute dynamique. Il est constitué d’un centre de traitement de données (CT, infrastructure à Grenoble) et une base de données des cibles observées et résultats associés (Diva+, infrastructure à Marseille). HC-DC est opéré par l’OSUG, l’OCA, Pytheas, l’Observatoire de Paris et l’Observatoire de Lyon.
Les tâches de service proposées
– Le premier concerne une participation obligatoire au traitement des données (import des données, réduction des données systématiques et à la demande), auquel peuvent être éventuellement assorti la participation à d’autres aspects des opérations du service (suivi des opérations de transfert de données CT-DIVA+, communication sur le SNO, documentation, suivi et correction des outils de réduction, etc.) ;
– Le second concerne un besoin de développement de nouveaux outils pour renforcer et étendre les services proposés : polarimétrie, développement de nouveaux outils et services DIVA+ (service VO, calculs d’orbites, et statistiques, outils graphiques, etc.), suivi de l’instrument, évolution de la chaîne de réduction, constitution de bibliothèque de référence en imagerie, veille technologique, etc.
Contact local : Hervé Le Coroller (LAM)
Responsable national : Nadège Meunier (IPAG/OSUG)
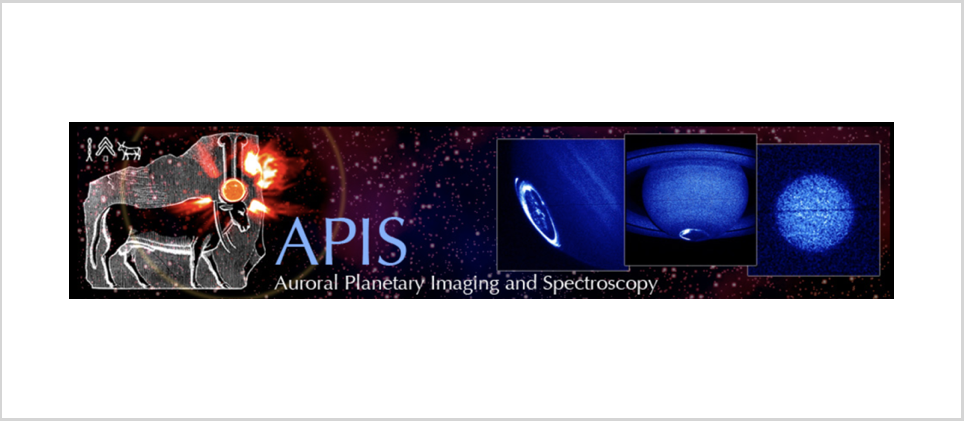
Description projet
Le service APIS (pour Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy) est un service de distribution de données de spectro-imagerie aurorale planétaire. Il est porté par deux observatoires des sciences de l’Univers, l’Observatoire de Paris et Pythéas, avec une équipe scientifique répartie au LESIA et au LAM sous la responsabilité de L. Lamy. Il bénéficie du soutien du centre Paris Astronomical Data Centre (PADC) et du Centre de donnéeS AstrophysiqueS de Marseille (CeSAM). Il a été labellisé ANO5 par l’INSU en 2016 et entre dans le cadre du Pôle National Thématique de Diffusion de Données de Physique des Plasmas. Ce service propose un accès ouvert et interactif à des observations aurorales des planètes du système solaire et de leurs satellites. De telles observations intéressent une large communauté à l’interface entre la planétologie, la physique des magnétosphères planétaires et l’héliophysique.
Plus précisément, APIS consiste en :
– plusieurs bases de données de haut niveau, construites à partir d’observations aurorales planétaires acquises par différents spectro-imageurs UV du télescope spatial Hubble, de la sonde Cassini ou du télescope spatial Hisaki (plus de 22000 observations individuelles à ce jour) ;
– une interface de recherche dédiée permettant de chercher rapidement et efficacement des données issues de ces bases à l’aide de critère de recherche conditionnels pertinents ;
– la possibilité de travailler directement en ligne avec les données retrouvées à l’aide d’outils de lecture d’images ou de spectres de l’Observatoire virtuel (OV). La compatibilité OV d’APIS a également permis de l’interfacer avec d’autres services OV (tels que le portail VESPA également hébergé à PADC ou les services AMDA, PropTool ou 3dview du Centre de Données de Physique des Plasmas).
Les tâches de service proposées
– Exploration, veille et rapatriement de jeux de données multi-longueurs d’onde à plus-value scientifique pour le service (Juno/UVS, JUICE/UVS) ;
– Construction de chaînes de traitement et de nouveaux niveaux de données à haute valeur ajoutée (science ouverte et principes FAIR) ;
– Développement d’outils spécifiques pour des verrous identifiés (Ex : centrage d’images, identification automatique de composantes etc.) ;
– Mise en base et compatabilité avec les standards de l’Observatoire Virtuel (OV) ;
– Interopérabilité et interfaçage entre le service et d’autres services/outils OV de la communauté (MASER, VESPA, CDPP, STORMS etc.) ;
Contact local : Laurent Lamy (LAM)
Responsable national : Laurent Lamy (LAM)
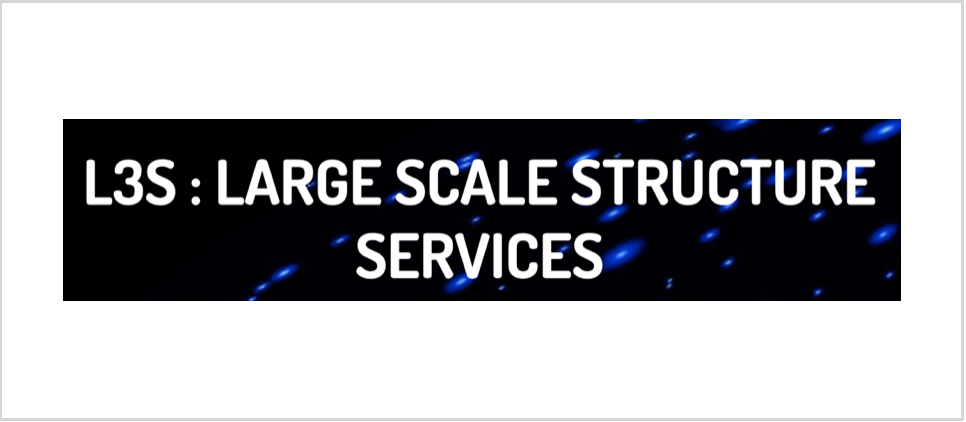
Description projet
L3S est un service qui mets à disposition de la communauté des services WEB (L3S/MAGYC et L3S/GAL-P) et des données à valeur ajoutée (L3S/SZDB, L3S/HESIOD et L3S/P-MAPS) qui résultent du traitement de haut niveau de données multi-longueurs d’onde (de l’infrarouge au millimétrique) sous forme de cartes d’émissions diffuses ou de catalogues. L3S est un service multi-OSU et se base sur les expertises multi-longueurs d’ondes développées à l’OSUPS, l’OSU Pytheas et l’OCA.
Les tâches de service proposées
– Expertise pour la réduction des données grandes longueurs d’ondes, notamment NIKA2,
– Réduction, validation et mise à disposition des données réduites et des codes associés,
– Développement et diffusion de codes/services à fortes valeurs ajoutées sur ces données, et
– Étude et prototypage de la distribution des données de nouveaux instruments observant à grandes longueurs d’ondes.
Contact local : Alexandre Beelen (LAM)
Responsable national : Marian Douspis (IAS)
ANO AA-ANO6 : Surveillance du Soleil et de l’environnement spatial de la Terre 1 (OSU Pythéas Responsable)
Les objets géocroiseurs et les débris en orbite ainsi que les phénomènes se produisant à la surface du Soleil, dans le vent solaire ou l’environnement ionisé de la Terre sont susceptibles d’affecter les performances et la fiabilité de dispositifs sol et spatiaux, de mettre en danger la vie ou la santé humaine. Leur prévision opérationnelle et leur surveillance systématique constituent la mission de cette ANO qui a, outre ses aspects sociétaux, des retombées scientifiques importantes, en particulier sur la compréhension des cycles solaires, sur la physique des relations entre l’héliosphère et la Terre, et sur la dynamique de l’environnement spatial de la Terre. La surveillance à long terme fournit de plus les données nécessaires pour explorer d’autres relations entre le Soleil et la Terre, comme par exemple la contribution potentielle de l’activité solaire à l’évolution du climat.

Description projet
Le réseau FRIPON réalise une surveillance continue du ciel pour détecter les bolides qui signalent les chutes de météorites et les retombées atmosphériques de débris spatiaux et, plus généralement, tout phénomène lumineux. Il est constitué à l’heure actuelle de 175 caméras “all sky” couvrant toute la France et une fraction de plusieurs pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse). Le réseau comporte également quelques caméras en dehors de l’Europe ainsi que 25 récepteurs radio (GRAVES) couvrant toute la France. Les données sont stockées et traitées à l’OSU Pythéas et alimentent des bases de données utilisées par plusieurs agences et par les communautés scientifiques nationales et internationales.
Les tâches de service proposées
– Gérer le réseau d’observation ;
– Gérer le stockage des données brutes des détections ;
– Traiter les données (déterminer orbites, trajectoires…) ;
– Valider scientifiquement les données brutes et traitées ;
– Gérer la base de données (optique et radio) des paramètres physiques et orbitaux des météoroïdes détectés ;
– Gérer les liens avec les réseaux instrumentaux utiles à l’interprétation des rentrées atmosphériques (sismographes, infrasons, autres réseaux optiques, …) ;
– Diffuser les données à la communauté et aux organismes concernés ;
Utiliser les données pour des actions de diffusion des connaissances et de formation auprès du grand public.
Contact local : Pierre Vernazza
Responsable national : Pierre Vernazza (LAM)