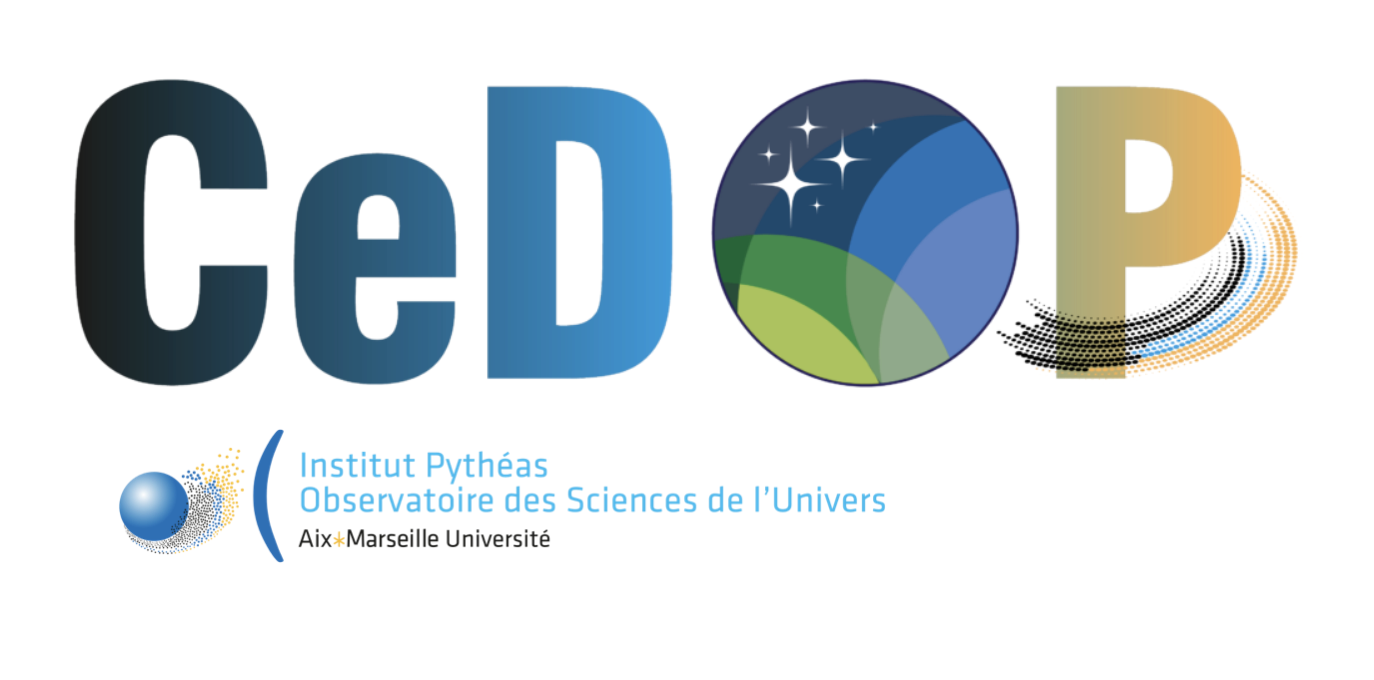Actions Nationales d’Observation INSU
Océan-Atmosphère
Au cours des dernières décennies, une stratégie internationale s’est mise en place pour acquérir les données nécessaires à la description du système climatique global, pour analyser les processus majeurs qui interviennent et pour quantifier leur rôle. Dans ce cadre, certaines observations récurrentes, à plus ou moins haute fréquence, et à long terme, sont rendues nécessaires pour l’étude de la dynamique des processus, avec souvent un vision régionale ou globale, mais aussi locale. Ces séries de données de longue durée sont acquises par l’INSU grâce à des services nationaux d’observation destinés à la mesure d’un nombre limité de paramètres océaniques ou atmosphériques, ainsi que des Sites Nationaux Instrumentés qui regroupent sur un même site une grande variété d’instrumentation et de mesures atmosphériques. De plus, l’importance de la modélisation numérique dans la recherche a amené l’INSU à soutenir un nombre restreint de codes numériques à vocation communautaire, dans le but de lui permettre de rester au plus haut niveau dans la compétition internationale.
Les Actions Nationales d’Observation
OSU Pythéas responsable ou partenaire
ANO OA-ANO1 : Services de surveillance de l’atmosphère 3 (OSU Pythéas Partenaire)

(OVSQ)
Description projet
ICOS est une infrastructure européenne à statut d’ERIC, inscrit sur la feuille de route ESFRI.
Au niveau Français ICOS-France est aussi une TGIR (Très Grande Infrastructure de Recherche), labélisée par le MENESR. La partie ICOS-atmosphère (également appelée RAMCES) dispose en outre d’une labélisation en tant que SNO.
ICOS a pour objectif scientifique la description des cycles biogéochimiques des principaux gaz à effet de serre additionnel (CO2, CH4, N2O, SF6) et la quantification des bilans de carbone à l’échelle régionale. Concernant le compartiment atmosphérique ICOS vise au suivi à long terme des concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre additionnel. Ces mesures permettront de quantifier les émissions de +9surface à l’échelle nationale et régionale, par une modélisation inverse du transport atmosphérique.

(OVSQ)
Description projet
Le NDACC (Network for Detection of Atmospheric Composition Change), anciennement NDSC (Network for Detection of Stratospheric Change), est un réseau international de surveillance sur le long terme de la stratosphère et de la haute troposphère créé en 1991. Il a pour objectifs la détection des changements de composition chimique et de température d’origine naturelle ou anthropique ainsi que l’étude des interactions entre chimie et climat, et la validation sur le long terme des observations des mêmes paramètres par les nombreux satellites mis en orbite depuis lors. Les activités françaises composent le Service d’Observation NDACC-France du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)/INSU (Institut National des Sciences de l’Univers) coordonné au niveau national par l’Observatoire de l’université de Versailles Saint-Quentin (OVSQ) sur un financement multi-organismes incluant le CNRS/INSU, ainsi que le CNES (Centre National des Etudes Spatiales), l’IPEV (Institut Paul-Emile Victor), la région de la Réunion et les universités partenaires.

(Ext OSU : LOA)
Description projet
Les propriétés optiques et microphysiques des aérosols, intégrées sur la colonne atmosphérique, sont quotidiennement mesurées ou déterminées en chaque point du réseau AERONET (AERosol Robotic NETwork) dédié à la caractérisation et la surveillance des aérosols et initié au début des années 1990, par les laboratoires Goddard Space Flight Center (GSFC) de la NASA et LOA de l’Université de Lille et CNRS Cet énorme travail de collecte de données et d’interprétation est nécessaire pour la compréhension du rôle des aérosols dans le climat et la qualité de l’air. Il est aussi très important pour l’évaluation des mesures radiatives effectuées depuis les satellites et les paramètres aérosols qui en sont dérivés. Le SNO a pour mission de mesurer le plus précisément et fréquemment possible l’épaisseur optique d’extinction en aérosol et les luminances spectrales descendantes.
ANO OA-ANO2 : Services d’observation de l’océan 3 (OSU Pythéas Partenaire)

(STAMAR)
Description projet
MOOSE est un système d’observations multi-plateformes et multi-sites, destiné à suivre de façon synoptique l’évolution du bassin nord-occidental de la Méditerranée (mer Ligure, golfe du Lion, bassin Provençal) dans le contexte des changements globaux (climatique et d’origine anthropique). Il s’agit en particulier de mesurer sa variabilité, les grandes tendances et les anomalies sur le long terme caractérisant l’évolution de cette région marine dont le périmètre a été également retenu comme sous-région par la Directive Cadre Stratégie des Milieux Marins (DCSMM). Le but de MOOSE est aussi de renseigner certaines structures et certains processus peu, ou mal étudiés, et dont le rôle dans les interactions physique/géochimie/biologie est fortement pressenti (variabilité des structures de communautés sur des échelles de temps allant de la saison au décennal, saisonnalité des activités à méso-échelle et leur influence sur les propriétés biogéochimiques des systèmes, variabilité générale des processus affectant le continuum côte-large, etc…).
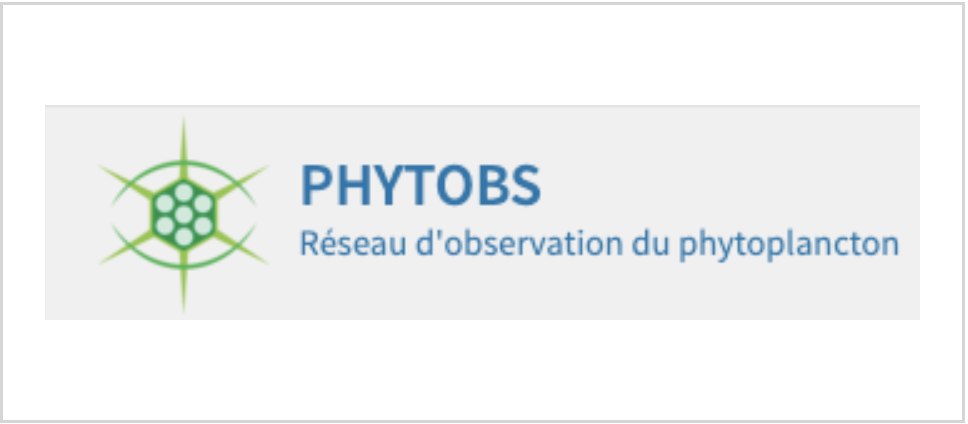
(OASU)
Description projet
PHYTOBS-Network est un Service National d’Observation (SNO) du microphytoplancton déployé sur les côtes françaises métropolitaines et porté par l’Ifremer, le CNRS et les Universités Marines. Un protocole commun s’applique pour les prélèvements, les analyses et l’identification. Les paramètres physico-chimiques associés à chaque échantillon sont disponibles avec les données PHYTOBS. Ces paramètres sont acquis par l’Ifremer ou par le réseau SOMLIT (www.somlit.fr), selon le site considéré.

(OASU)
Description projet
L’objectif scientifique du SOMLIT est donc 1) de caractériser l’évolution pluri-décennale des écosystèmes côtiers et littoraux, et 2) d’en déterminer les forçages climatiques et anthropiques. Afin de répondre à cet objectif, un suivi multi-sites coordonné à l’échelle nationale a été mis en place au milieu des années 90. Ce suivi repose actuellement sur une stratégie commune à l’ensemble des 12 écosystèmes suivis : 1) des prélèvements d’eau et mesure en surface, à pleine mer (pour les sites soumis à la marée), tous les 15 jours pour un cortège de 13 paramètres ‘historiques’ (température, salinité, oxygène dissous, pH, nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, silicate, matière en suspension, chlorophylle a, carbone et azote organiques particulaires) auxquels se sont ajoutés dans le milieu des années 2000 trois paramètres (isotopes stables du carbone et de l’azote organiques particulaires, ainsi que le pico-nanoplancton) et 2) des profils verticaux de sondes multiparamétriques concernant un cortège restreint de paramètres (température, salinité, fluorescence, PAR). Ces travaux sont effectués sous démarche qualité (le référentiel qualité du Somlit est basé sur la norme ISO 17025). Le SOMLIT possède également des objectifs de service : mise à disposition des données et support logistique aux activités de recherche et à d’autres activités d’observation.
ANO OA-ANO5 : Sites nationaux d’observation 1 (OSU Pythéas Responsable)

(PYTHEAS)
Description projet
L’Observatoire de Haute-Provence – UMS Pythéas est un site d’observation, de recherche et de formation de l’INSU du CNRS pour l’astronomie, l’environnement et l’étude de l’atmosphère. Il se situe en région SUD-PACA, à 20 km au nord de Manosque, 80 km de Marseille, à 650 m d’altitude.
L’ « OHP-GEO » est le volet de l’OHP qui regroupe ses activités atmosphériques et de surveillance de l’environnement.
L’OHP-GEO est labellisé depuis 2020 par l’INSU en tant que Site Instrumenté (SI). A ce titre, il assure trois missions:
- Une mission de recherche de long-terme autour de 3 thématiques de recherche principales s’appuyant sur les instruments de 3 Services Nationaux d’Observation (SNO) de l’INSU : ICOS-Fr, NDACC-Fr et Photons-AERONET.
- Une mission d’accueil de chercheurs lors de campagnes de terrain. Il accueille des chercheurs de toutes nationalités qui utilisent ses moyens performants.
- Une mission d’enseignement et de formation, en accueillant chaque année plusieurs centaines d’étudiants, notamment lors du stage national SIMO et de l’école européenne ERCA.